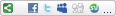NEWSLETTER CHRISTUSKIRCHE 15. Mai 2021
 GOTTESDIENST - 16. Mai 2021
GOTTESDIENST - 16. Mai 2021
 KINDER & KIRCHE
KINDER & KIRCHE
 ÜBER DEN TELLERRAND - Pfarrer Hans-Helmut Peters und sein „Dienst eines Friedens von morgen oder übermorgen.“ - Teil 1
ÜBER DEN TELLERRAND - Pfarrer Hans-Helmut Peters und sein „Dienst eines Friedens von morgen oder übermorgen.“ - Teil 1
DER ETWAS ANDERE NEWSLETTER
Glück ist: Das Leben genießen - und damit Gott loben.
„Beim Jüngsten Gericht wird der Mensch Rechenschaft ablegen müssen über alle guten Dinge, die er hätte genießen können, aber nicht genossen hat.“ Das ist ein Satz aus dem Talmud, dem heiligen Lehrbuch der Juden. Ein wunderbarer Satz, ebenso heiter wie wahr. Wie oft vergesse ich das, wenn eine Arbeitswoche mich in Atem hält? Und ist „Glück“ nicht in diesen schwierigen Monaten des Lockdowns zu einer Währung geworden, die sich kaum jemand noch leisten kann?
Der mich und dich gemacht hat, wird uns nach diesem Leben interessiert fragen, was aus dem Besten, das er mir und dir gegeben hat, geworden ist. Ich hoffe auf seine Vergebung, wenn ich oft nicht getan habe, was ich hätte tun sollen. Oder wo ich weggeschaut habe, wo ich hätte handeln sollen und alle meine sonstigen Verfehlungen. Aber dass ich das Einfachste und Naheliegendste versäumt habe – da wird er mich fragen: Warum? Warum nur hast du nicht genossen, was zu genießen war?
Haben Sie sich die Frage schon einmal gestellt: Warum habe ich oft so gelebt, als hätte alles Schöne und Genussvolle noch Zeit? So wie es in einem deutschen Schlager heißt: Erst musste ich noch die Welt retten und meine 148 Mails beantworten, aber dann hätte ich mir Zeit für Muße gegönnt. Aufgeschoben ist dann doch aufgehoben. Versäumt – Perdue. Leben im Aufschub. Warum kann ich mich erst im Urlaub frei machen von all dem, was mich sonst bestimmt und beeinflusst, ja „im Griff“ hat? Warum entgehen mir an einem gewöhnlichen Tag die vielen Wunder, die mir geschenkt werden? Eine Geldfrage ist es nicht. Genuss fängt nicht erst bei Kalbfleisch und Champagner an. Alles lässt sich genießen: was der Haut wohltut, was Augen und Ohren erfreut, das Herz erwärmt, den Geist anregt und natürlich auch, was dem Gaumen schmeckt. Alles: Die Bettwärme am Morgen, das Räkeln, Sich-noch-einmal-genüsslich-ausstrecken, manchmal sogar das Zähneputzen. Ich muss nur bei der Sache sein. Mich einlassen können. Genießen ist immer eine Frage der Aufmerksamkeit. Wer oder was sollte mich daran hindern?
Eine ganze Menge, ich weiß. Die anderen. Die Konventionen. So viele verinnerlichte Moralismen, die da lauten: Arbeitszeit ist doch nicht Freizeit! Das zu tun ist doch nicht schicklich! Meine Mutter ermahnte mich früher: Tu das nicht! Was sollen denn die Leute denken? Und dann noch die eigene innere Stimme: Du musst auch mal verzichten können! Denk an deine Pflicht! Dazu kommt häufig noch das diffuse Gefühl, gehetzt zu werden, und selber andere in die Tretmühle zu zwingen, irgendetwas muss doch immer gemacht oder verantwortet werden.
Oft ist das Leben wirklich zu schwer, um es noch genießen zu können. Es wird also am Ende gewiss so sein, dass ich vieles, was ich hätte genießen können, nicht genossen habe. Darin werde ich dem, der mich gemacht hat, etwas schuldig bleiben. Aber ich will ihm nicht alles schuldig bleiben. Was werde ich antworten, wenn er mich beim Jüngsten Gericht fragt: Was hast du mit Aufmerksamkeit genossen in der Lebenszeit von 75 und mehr Jahren, die ich dir geschenkt habe?
Ich frage Sie: Welche Dinge fallen Ihnen ein, die Sie in den zurückliegenden Jahren genießen konnten? In den Urlauben, die hoffentlich bald wieder möglich werden? In Begegnungen mit lieben Menschen, die Ihnen vertraut und nahe sind? Vielleicht fallen Ihnen ein: Die Wanderungen im Gebirge. Toben und Schwimmen mit den Kindern oder Enkeln im Meer. Die wunderbare Verköstigung auf einem Weingut im portugiesischen Alentejo. Endlich mal wieder Zeit zum Lesen. Die kontemplative Stille in einer der vielen schönen Kirchen hier in Paris. Der tiefblaue Himmel, an dem weit oben Flugzeuge vorüberziehen. Die Stunden entspannten Plauderns über „Gott und die Welt“ - Augenblicke, die das Leben lebenswert machen. - Das hat doch was, mir das Jüngste Gericht vorzustellen, wie ich mich vor dem Ewigen verbeuge und denke: „Mein Gott, wie wunderbar war so ein Sommertag!“
Rechenschaft ablegen über Genüsse, Glück zu genießen – das ist im Grunde nichts anderes als Gott zu loben. Der Schriftsteller Bertolt Brecht hat seinen Rechenschaftsbericht über Genüsse mal in einem Gedicht niedergeschrieben, das er mit dem Wort „Vergnügungen“ betitelt hat. Seine Genüsse sind folgende:
„Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen – Das wiedergefundene alte Buch - Begeisterte Gesichter - Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten - Die Zeitung, der Hund - Duschen, schwimmen - Alte Musik, neue Musik - Bequeme Schuhe - Begreifen, schreiben, pflanzen - Reisen, singen, freundlich sein.“
Was käme in Ihrem Gedicht vor, wenn Sie über „Vergnügungen und Genüsse“ nachdenken, über Augenblicke in denen Sie sich einfach glücklich fühlten und das Leben genießen konnten? Darüber nachzudenken ist eine kleine, lohnenswerte Aufgabe zum Lobe Gottes!
P. Hartmut Keitel
 GOTTESDIENST - 16. Mai 2021
GOTTESDIENST - 16. Mai 2021
Exaudi
Gottesdiest um 10.30 Uhr mit Pastor Hartmut Keitel
> Kollekte: Schule in Irbid, Jordanien
GOTTESDIENST - 23. Mai 2021
Pfingstsonntag
Gottesdienst mit Abendmahl um 10.30 Uhr mit Pastor Hartmut Keitel
- Einsegnung der Mitglieder des Kirchenvorstands & Verabschiedung Lore de Chambure
- parallel dazu Kindergottesdienst
> Kollekte: Konfirmandenarbeit
Wann und wie? > Anmeldungen bitte möglichst bis Freitagmittag im Sekretariat an secretariat@christuskirche.fr ! Bitte geben Sie alle vollständigen Namen, Telefonnummern und die Mailadressen an.
> Als Livestream über den Link + Passwort: Paris, Zugang zum Livestream ab 10:15. Dringliche Bitte an die ZuhörerInnen: Stellen Sie bitte Ihre Mikrophone während der Übertragung ab!
>> Die Kollekte vom 2. Mai für die Kirchenmusik betrug 143,87 €. Am 9. Mai wurden 96,00 € für den Bund Evangelischer Kirchen in Frankreich (FPF) gesammelt. Vielen Dank für Ihre Kollekte. Gott segne Geber, Gaben und Empfänger.
Wie? Die Kollekte wird gesammelt über die Homepage der Christuskirche (Spendenzweck: "Kollekte der Woche") oder postalisch per Scheck. Herzlichen Dank für Ihre Gaben!
Wenn der „Kinderglaube“ an den „lieben Gott“ aufhört – was kommt dann? Ist es für Jugendliche uncool, überhaupt an Gott zu glauben oder finden sie einen Weg, wie ihr Glaube erwachsen werden kann? Bei diesen Fragen wollen wir die Jugendlichen begleiten und ihnen helfen, ihre Zweifel, ihre Hoffnung, ihre Sehnsucht zu benennen und ihren eigenen Glaubensweg zu gehen. Nach der Rentrée wollen wir im September mit einem neuen Konfirmandenjahrgang in unserer Kirchengemeinde beginnen. Er wird begleitet von unserer neuen Pastorin Barbara Franke.
Bitte merken Sie folgende Termine schon vor:
* 12.09. 10.30 Uhr: Gottesdienst, danach erstes Infotreffen mit den Eltern, auf dem Sie auch eine Übersicht über die Termine des Konfirmandenjahres erhalten. Bitte bringen Sie zu diesem Treffen eine Geburts- und Taufurkunde (soweit vorhanden) mit.
* 03.10. 10.30 Uhr: Begrüßung der neuen Konfirmand*innen im Gottesdienst am Erntedankfest.
* 05.06. 2022: Konfirmation im Gottesdienst am Pfingstsonntag.
ALTER: Konfirmand*innen sollten bei der Konfirmation (Pfingsten 2022) mindestens 14 Jahre alt sein.
MONATLICHE TREFFEN: Die Treffen finden meistens sonnabends von 14.00 – 18.00 h in der Rue Blanche statt. Zwei Wochenenden gehören ebenfalls dazu.
THEMEN: Den Jugendlichen möchten wir die Grundlagen des christlichen Glaubens vermitteln mit Themen wie: Gottesbilder, Leben Jesu, Bibel, Schöpfung, Gebet, Gebote, Glaube, Diakonie (Nächstenliebe). Die Themen sollen aber auch an den Interessen und Fragen der Jugendlichen orientiert sein und in Rollenspielen, Diskussionsrunden und Kleingruppenarbeit erarbeitet werden Ein gutes Miteinander in der Gruppe ist uns dabei wichtig.
VORAUSSETZUNGEN:
* Relativ gute Deutschkenntnisse, da die Treffen auf Deutsch stattfinden.
* Eigene Bereitschaft, sich auf religiöse Themen einzulassen.
* Bereitschaft, in der Konfirmandenzeit mindestens 10 Gottesdienste (in der Christuskirche oder anderswo) zu besuchen.
* Bereitschaft, die wichtigsten Texte des Christentums (Vaterunser, Glaubensbekenntnis, Psalm 23, 10 Gebote) auswendig zu lernen.
* Taufe ist KEINE Voraussetzung, eine Tauffeier kann im Rahmen der Konfirmandenzeit stattfinden.
Um gut planen zu können, möchten wir Sie bitten, die Anmeldung zur Konfirmandenzeit 2021/2022 bis Ende Juli in unserem Sekretariat abzugeben.
Wir freuen uns darauf, Sie und die neuen Konfirmand*innen persönlich kennen zu lernen.
P. Hartmut Keitel
KIRCHENJAHR - Sonntage „Exaudi“ und „Pfingsten“
Der 6. Sonntag nach Ostern heißt „Exaudi“. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern, ehe Gott ihnen den Heiligen Geist schenkt und die Kraft Christi in ihnen verwurzelt. Abschiede sind zwiespältig. Deshalb ergeht an diesem Sonntag der Hilferuf: Exaudi. Erhöre mich. „Pfingsten“ wurde als Fest im frühen Christentum aus dem jüdischen Festkalender übernommen als der 50. Tag nach Passah. Dieser Tag schloss die Osterzeit als fünfzigtägige Freudenzeit ab. Ende des 4. Jahrhunderts rückte das Gedächtnis der Geistsendung in den Mittelpunkt und damit entstand ein eigenständiger Festtag.
 KINDER & KIRCHE
KINDER & KIRCHE Liebe Kinder, endlich konnten wir am 2. Mai wieder mit dem Kindergottesdienst in der Christuskirche starten. Wir haben zusammen gebetet, gesungen, eine Geschichte gehört und gespielt. Schön, wenn wir uns auch zu den nächsten Terminen im Mai und Juni sehen würden:
23. Mai: Pfingstkindergottesdienst im großen Saal für alle „kleinen und großen Kinder" mit einem Elternteil, das auch teilnehmen könnte.
13. Juni: Kindergottesdienst ab 6 Jahren.
27. Juni: Kindergottesdienst für die Kleineren von 0 bis 5/6 Jahren.
Bitte meldet euch zu den Angeboten zeitig und mit Altersangabe im Sekretariat an: secretariat@christuskirche.fr.
Liebe Grüße von Eurer Sabine Gerlach
Wann und wo? Bitte melden Sie sich bis Mittwochmittag (19.5) bei Pfarrer Keitel unter der Mailanschrift (hartmut.keitel@christuskirche.fr) an. Die Zugangsdaten erhalten Sie im Laufe des Donnerstags per Mail. Über Ihre Teilnahme würden wir uns freuen!
Wann und wo? Wenn Sie uns über [newsletter@christuskirche.fr] bis Donnerstagabend, den 20.5, Bescheid geben, senden wir Ihnen am Freitag die Telefonnummer mit den Zugangsdaten zu.
 ÜBER DEN TELLERRAND - Pfarrer Hans-Helmut Peters und sein „Dienst eines Friedens von morgen oder übermorgen.“ - Teil 1
ÜBER DEN TELLERRAND - Pfarrer Hans-Helmut Peters und sein „Dienst eines Friedens von morgen oder übermorgen.“ - Teil 1
Sehr gerne lese ich in der 1994 zum 100jährigen Jubiläum der Christuskirche von dem damaligen Pfarrer Wilhelm von der Recke herausgegebenen „Gemeindechronik“. Manches liest sich so spannend als hätte es aus der Feder von John le Carré in einem seiner Agentenromane sein können. Vor allem das Kapitel „Die Gemeinde während der Zeit der deutschen Besetzung – August 1940 bis August 1944.“ Wie stellte sich „Kirche als Teil der Besatzungsmacht im fremden Land“ (Chronik = Chr, 181) dar? „Wie hat sich der Pfarrer in dieser Situation verhalten? Welche Motive bewegten ihn? Welche Spielräume blieben ihm?“ (Chr, 181). Pfarrer in Paris war seit Juli 1940 der frankophile Hans-Helmut Peters, der schon als Vikar 1930/31 Paris kennengelernt hatte und in den Dreißiger Jahren als Reiseprediger in Nizza tätig war. Aus einem Schreiben der deutschen Botschaft aus jenen Sommertagen 1940 geht hervor, „dass Peters in erster Linie als Beauftragter der staatlichen Stellen nach Paris ging und seine kirchliche Tätigkeit als Gemeindepfarrer als Tarnung für seine eigentliche Aufgabe, die französischen Protestanten zur Zusammenarbeit mit den Deutschen zu bewegen, anzusehen ist“ (Chr, 184). Auch die SS war mit der Entsendung von Pfarrer Peters einverstanden. Das pastorale Wirken von Peters erfährt in den kommenden Jahren von vielen Seiten Anerkennung, weil er sozusagen „zwischen den Linien“ agiert und dies auf sehr menschliche Weise. In der prekären Situation der deutschen Besatzungszeit zeigte er keinen weltanschaulichen Hang zu nationalsozialistischen Doktrinen und Überzeugungen. Die Begegnung von Mensch zu Mensch steht für ihn im Vordergrund „mit sehr unterschiedlichen Menschen: mit dem französischen Widerstandskämpfer, mit dem SS-Mann, mit dem Botschaftsrat, mit dem Arbeiter und mit dem General“ (Chr, 186). Peters wurde ab September 1941 zum „Standortpfarrer im Nebenamt“ für die deutschen Soldaten ernannt. Ebenso ging er neben seiner Arbeit als Pfarrer in der Rue Blanche als Seelsorger in das Militärgefängnis nach Fresnes, um französischen protestantischen Zivilgefangenen, aber auch anderen Inhaftierten, beizustehen. Über diese Tätigkeit ist wenig bekannt, „da sie sich naturgemäß im halböffentlichen Raum abspielte und Peters nichts aus seinen eigenen Arbeitsunterlagen hinterlassen hat“ (Chr, 187). Die Chronik hält fest, dass Peters Tätigkeit als Gefängnisseelsorger „die am schwersten zu ertragende Arbeit gewesen sein (muss), für die der Pfarrer am meisten Kraft brauchte. Sie war ihm die wichtigste“ (Chr, 194). Die Aufgabe der geistlichen Betreuung der protestantischen französischen Zivilgefangenen wurde ihm von General Hans Speidel, früherer Legationsrat der deutschen Botschaft, übertragen. „Im Gefängnis in Fresnes saßen zahlreiche französische Résistancekämpfer, die von der deutschen Polizei festgenommen worden waren. Es war ein Untersuchungsgefängnis, also eine Durchgangsstation, in der man auf das Urteil wartete. Ein Militärgericht entschied über das Schicksal: Hinrichtung oder Gefängnisstrafe oder Deportation“ (Chr, 194). Auch Peters begleitete wie sein damaliger katholischer Kollege Abbé Stock die zum Tod Verurteilten zur Hinrichtung auf dem Mont Valérien und stand den Familien bei. Eine Zeitzeugin berichtet in der Chronik über die Tätigkeit von Peters:
„Pastor Peters war überall bekannt. Er war kein Widerstandskämpfer, er hat in seinem Pastorenamt alles gemacht, was er zu machen hatte, gewissensmäßig. Er hat französische Gefangene besucht. Na, ja, er hat viel mehr gemacht, als er eigentlich machen durfte. Aber man ließ ihn, weil er es war. (…) Peters sagte manchmal, er hätte immer arretiert werden können, weil er an der Grenze sei. Er machte, was zu machen war, pastorenmäßig gesehen, und er hat natürlich vielen geholfen, die er nicht hätte kennen müssen“ (Chr, 195). Peters selbst berichtet in seinen Erinnerungen, dass er „bei den Besuchen in den Zellen (fest)stellte, dass die Gefangenen großes Verlangen hatten, von ihren Familien etwas zu erfahren. Mir war ganz deutlich, dass ein Kontakt über mich zu den Familien nicht hergestellt werden durfte. (…) Auf der anderen Seite war mir klar, dass dieses ein Brückendienst des Friedens sein könnte und dass die Angehörigen seelisch eine unwahrscheinliche Entlastung haben würden, wenn sie wüssten, hier können wir mit einem Menschen sprechen, der unsere Inhaftierten besucht hat. Dadurch entstand diese Sprechstunde am Mittwochnachmittag, die zeitweilig von 30 – 40 Menschen besucht wurde. Im Stillen hielt ich mir immer wieder vor, unter diesen Besuchern ist irgendein Spitzel der Gestapo, der hier nur gekommen ist, um am Ende zu sagen, was Sie hier machen ist illegal und wir müssen Sie verhaften. Während meiner ganzen Zeit in Paris habe ich damit gerechnet, verhaftet zu werden; denn einiges ist auch im Gefängnis geschehen, was am Rande und wahrscheinlich auch außerhalb der Legalität war. (…) Aber ich habe mich immer damit getröstet, dass ich sagte: Wenn Gott will, dass dieser Dienst, den ich als Dienst eines Friedens von morgen oder übermorgen ansah, - wenn Gott will, dass dieser Dienst zu Ende geht, dann soll es geschehen; und wenn er Seine Hand darüber hält, dann will ich weiter den Menschen dienen, so gut es geht“ (Chr, 196). Für seine Tätigkeit in Fresnes wurde Peters Anerkennung zuteil, auch vom Conseil National der Fédération Protestante. Peters war gewiss kein Widerstandskämpfer, in einer offenen kritischen Haltung gegenüber dem Dritten Reich tritt er nicht auf. Er verstand seine Aufgabe „als Dienst eines Friedens von morgen oder übermorgen.“ Wichtig war ihm „die menschliche Hilfe als Brücke zwischen kriegführenden Nationen für den Friedensschluss nachher, als eine Art Kapital, um wieder zu einem Vertrauensverhältnis kommen zu können. Den Franzosen zeigen, dass nicht alle Deutschen ihren Mitmenschen Böses antun, dass es Menschlichkeit über alle trennenden Unterschiede hinweg gibt. Damit blieb Peters seiner Haltung der Dreißiger Jahre treu, wo er mit dem SS-Mann ebenso wie mit dem Vertreter der Bekennenden Kirche zu reden verstand“ (Chr, 201).
-----------
Zu dem Kapitel „Die Gemeinde während der Zeit der deutschen Besetzung“ wird in der Chronik angemerkt: „Dieses ganze Kapitel muss unter dem Vorbehalt gelesen werden, dass es sich um den im Frühjahr 1994 verfügbaren Wissensstand handelt. Die Quellenbasis ist unvollständig“ (Chr, 181). Mittlerweile gibt es eine neue Quelle, in der ein Zeitzeuge über seinen Kontakt mit Pfarrer Peters im Militärgefängnis in Fresnes berichtet. Lesen Sie im nächsten Newsletter: „Wie Pfarrer Peters einem prominenten Häftling das Leben rettete.“
P. Hartmut Keitel
« Lors du Jugement dernier, l’homme devra rendre des comptes pour toutes les bonnes choses dont il aurait pu profiter, mais dont il n’a pas profité. » Voici une phrase du Talmud, livre sacré des Juifs, une phrase merveilleuse aussi sereine que vraie. Combien de fois est-ce que je l’oublie lorsqu’une semaine de travail me tient en haleine ? Et est-ce que, au cours de ces mois difficiles du confinement, « le bonheur » n’est pas devenu une monnaie d’échange que personne, ou presque, ne peut toujours s’offrir ?
Celui qui nous a faits, toi et moi, nous demandera après cette vie, curieux, ce qu’est devenu le meilleur qu’il nous a donné, à toi et à moi. Je compte sur son pardon lorsque, souvent, je n’ai pas fait ce que j’aurais dû faire. Ou encore, là où j’ai détourné le regard alors que j’aurais dû agir … ainsi que tous mes autres manquements. Mais que j’aie omis le plus simple et le plus évident – là, il me demandera : pourquoi ? Pourquoi n’as-tu donc pas profité de ce qu’il y avait pour en profiter ?
Vous êtes-vous déjà posé la question suivante : pourquoi ai-je souvent vécu comme si tout ce qui est beau et extrêmement agréable pouvait encore attendre ? Comme le dit un tube allemand : ‹ Faut juste que je sauve d’abord le monde et que je réponde à 148 courriels › … mais ensuite, je me serais accordé du temps libre. (Nur noch kurz die Welt retten, de Tim Bendzko). Projet remis est bien projet enterré. Manqué, raté – perdu. La vie – reportée. Pourquoi est-ce seulement en vacances que je peux me libérer de tout ce qui me détermine et m’influence, voire, m’a « sous contrôle » ? Pourquoi, un jour normal, les nombreuses merveilles dont on me fait cadeau m’échappent ? Ce n’est pas une question d’argent. La jouissance ne commence pas par la viande de veau et le champagne. Tout se prête à en profiter : ce qui fait du bien à la peau, ce qui fait plaisir aux yeux et aux oreilles, ce qui fait chaud au cœur, ce qui stimule l’intellect et, bien sûr, ce qui amuse les papilles. Tout : la tiédeur du lit, le matin ; s’étirer, s’étendre encore une fois avec plaisir ; parfois même le brossage des dents. Je dois juste avoir le cœur à l’ouvrage. Pouvoir y consentir. Profiter est toujours une question d’attention. Qui ou quoi pourrait m’en empêcher ?
Un tas de choses, je le sais. Les autres. Les conventions. Un si grand nombre de moralismes intériorisés au sens de : ‹ Mais le temps de travail n’est pas du temps libre ! › – ‹ Faire ceci ou cela n’est pas convenable ! › Autrefois, ma mère m’exhorta : « Ne fais pas ça ! Que diront les gens ? » Et puis, la voix intérieure propre à tout un chacun : ‹ Tu dois être capable de renoncer, pour une fois ! Pense à ton devoir ! › S’ajoute souvent le sentiment diffus d’être pourchassé ou encore, d’enfermer les autres dans une morne routine ; il y a toujours quelque chose que l’on doit faire ou dont on doit prendre la responsabilité.
Souvent, la vie est vraiment trop dure pour que l’on puisse en profiter. En fin de compte, je n’aurai pas profité de beaucoup de choses dont j’aurais pu profiter. En cela, je resterai le débiteur de celui qui m’a fait. Mais je ne veux pas rester son débiteur à cent pour cent. Qu’est-ce que je répondrai quand, lors du Jugement dernier, il me demandera : « De quoi as-tu profité, consciemment, pendant la période de vie de 75 ans et plus dont je t’ai fait cadeau ? »
Je vous demande : Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit dont vous avez pu profiter, ces dernières années ? Au cours des congés qui, espérons-le, seront bientôt de nouveau possibles ? Au cours de rencontres avec des personnes chéries qui vous sont proches et familières ? Vous vous souviendrez peut-être de promenades dans la montagne ; d’avoir fait le fou et d’avoir nagé dans la mer avec les enfants ou avec les petits-enfants ; de la nourriture incroyablement délicieuse servie dans une cave à vin à Alentejo, au Portugal. Enfin du temps pour lire. Le silence contemplatif dans l’une des nombreuses belles églises, ici à Paris. Le ciel bleu intense dans lequel, très haut, des avions passent. Les heures de bavardage détendu où nous refaisions le monde. Des moments qui font que la vie vaut la peine. C’est quelque chose que de m’imaginer le Jugement dernier, comme je m’incline devant l’Éternel en pensant : « Mon Dieu, combien était merveilleuse une journée estivale ! » Rendre des comptes sur des jouissances, profiter du bonheur – au fond, ce n’est rien d’autre que des louanges de Dieu. L’écrivain Bertolt Brecht a noté son compte rendu concernant les jouissances dans un poème qu’il a intitulé « Vergnügungen » (Divertissements.) Ses divertissements, plaisirs sont les suivants : « Le premier regard par la fenêtre – le vieux livre retrouvé – des visages enthousiastes – la neige, le changement des saisons – le journal, le chien – prendre une douche, nager – la musique ancienne, la musique contemporaine – des chaussures confortables – comprendre, écrire, planter – voyager, chanter, être aimable. »
Qu’est-ce qu’on trouverait dans v o t r e poème lorsque vous réfléchissez sur les « divertissements et jouissances », sur les moments où vous vous sentiez tout simplement heureux, heureuse et où vous pouviez profiter de la vie ? Y réfléchir est une petite tâche qui vaut la peine, à la louange de Dieu.
Pasteur Hartmut Keitel
Exaudi
16 mai - 10 h 30 : Pasteur Hartmut Keitel
> Offrande : pour l’école à Irbid, en Jordanie
CULTE AVEC SAINTE-CÈNE
le dimanche de Pentecôte
23 mai - 10 h 30 : Pasteur Hartmut Keitel
Bénédiction des membres du Conseil presbytéral ⎮ Adieu à Lore de Chambure
> Offrande : pour le travail avec les confirmands et les confirmandes
Quand et comment? > Veuillez vous inscrire sur secretariat@christuskirche.fr en indiquant votre nom et prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel.
> Vous pouvez assister au culte en vous connectant à https://konferenz.buehl.digital/GoDiParis, mot de passe: Paris.
Merci de bien vouloir éteindre vos microphones.

OFFRANDES
>> L’offrande du 2 mai, pour la musique dans notre église, fut d’un montant de 183,87 €, celle du 9 mai, pour la Fédération Protestante de France (FPF) de 96 €. Que Dieu bénisse donateurs, dons et destinataires.

 ENFANTS & ÉGLISE
ENFANTS & ÉGLISE
Comment ? Vous pouvez les déposer à la sortie après le culte, nous les faire parvenir par chèque ou encore en allant sur le site de la Christuskirche.

NOUVELLE PROMOTION DE CONFIRMANDES ET DE CONFIRMANDS
Lorsque la croyance enfantine en un « bon Dieu » prend fin – qu’est-ce qui vient après ? Est-ce que, pour les jeunes, il n’est pas cool de croire en Dieu d’une façon ou d’une autre ou encore, trouvent-ils un moyen d’atteindre une « croyance adulte » ? Nous voulons accompagner les jeunes qui se posent ces questions et les aider à mettre un nom sur leurs doutes, leur espoir, leur désir ardent et à emprunter le chemin de la foi qui leur est propre.– Après la Rentrée, en septembre, nous allons mettre en place une nouvelle promotion de confirmandes et de confirmands, dans notre paroisse. Elle sera guidée, accompagnée par notre nouvelle pasteure, Madame Barbara Franke.
Veuillez déjà noter les dates suivantes :
– le 12 septembre, 10 h 30 : culte, puis première rencontre d’information avec les parents, au cours de laquelle vous recevrez également un tableau synoptique de toutes les dates. Veuillez apporter, si disponible, un certificat de naissance et une attestation de baptême.
– le 3 octobre, 10 h 30 : mot de bienvenue destiné aux confirmandes et aux confirmands, au cours du culte d’Action de grâce pour la récolte (Erntedankfest).
– le 5 juin 2022 : confirmation au cours du culte du dimanche de Pentecôte.
ÂGE : Les futurs confirmands, garçons et filles, devraient avoir au moins 14 ans lors de la confirmation, à la Pentecôte de 2022.
RÉUNIONS MENSUELLES : Le plus souvent, les réunions auront lieu le samedi, de 14 à 18 h, rue Blanche. En outre, deux week-ends sont prévus.
THÈMES : Nous souhaitons transmettre aux jeunes les bases de la foi chrétienne en examinant des sujets tels que : des images/représentations de Dieu, la vie de Jésus, la Bible, la création, la prière, les commandements, la foi, la diaconie (amour du prochain). Cependant, les thèmes doivent aussi correspondre aux intérêts et aux questions des jeunes et prendre les formes de jeux de rôles, de cercles de discussion et de travail en petits groupes. Une bonne coopération à l’intérieur du groupe nous importe beaucoup.
CONDITIONS
- Assez bonne maîtrise de l’allemand, les réunions ayant lieu dans cette langue,
- Être prêt, prête à se lancer dans des sujets religieux,
- Être prêt, prête à assister à au moins 10 cultes, à la Christuskirche ou ailleurs au cours de la période de préparation à la confirmation,
- Être prêt, prête à apprendre les textes les plus importants de la chrétienté (le Notre Père, la Confession de la foi, le psaume 23, les 10 commandements) par cœur
- Être baptisé N’EST PAS une condition ; le baptême pourra avoir lieu au cours de la période de préparation à la confirmation.
Afin de pouvoir planifier comme il faut, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir déposer/faire parvenir le formulaire d’inscription à la période de préparation à la confirmation 2021/2022 au secrétariat jusqu’à fin juillet (secrétariat@christuskirche.fr).
Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer personnellement, vous et les futurs confirmands – filles et garçons.
P. Hartmut Keitel
ANNÉE LITURGIQUE - Les dimanches Exaudi et Pentecôte
Le sixième dimanche après Pâques s’appelle « Exaudi ». Jésus prend congé de ses disciples avant que Dieu ne leur donne le Saint Esprit et fait s’enraciner en eux la force du Christ. Les adieux sont ambivalents. C’est pour cela que, en ce dimanche, s’élève l’appel au secours : Exaudi. Écoute-moi.– Au début du christianisme, « la Pentecôte » fut, en tant que fête, reprise du calendrier juif des fêtes, comme le 50ème jour après Pessa’h.
Ce jour termina la période de Pâques en tant que période de fête de cinquante jours. À la fin du IVe siècle, la commémoration du don du Saint Esprit devient le centre d’intérêt, et c’est ainsi qu’un jour de fête ‹ autonome › fut créé.
 ENFANTS & ÉGLISE
ENFANTS & ÉGLISEChers enfants,
Enfin, nous avons pu commencer à célébrer de nouveau le culte pour enfants à la Christuskirche, le 2 mai ! Nous avons prié et chanté ensemble, nous avons écouté une histoire et joué. Ce serait bien si nous pouvions nous voir lors des prochaines dates en mai et en juin :
– le 23 mai : culte de Pentecôte dans la Grande Salle pour tous les grands et les petits, accompagnés de l’un des parents qui pourrait également participer,
– le 13 juin : culte pour enfants à partir de 6 ans,
– le 27 juin : culte pour les plus petits, de 0 à 5/6 ans.
Veuillez vous inscrire rapidement sur secretariat@christuskirche.fr en indiquant votre âge.
Avec mes salutations chaleureuses,
Sabine Gerlach
 CERCLE DE DISCUSSION AUTOUR DE LA FOI - 20 mai - 19 h 30 - Sujet : les quatre dernières demandes du « Notre Père »
CERCLE DE DISCUSSION AUTOUR DE LA FOI - 20 mai - 19 h 30 - Sujet : les quatre dernières demandes du « Notre Père »
Nous terminerons l’échange d’idées autour du « Notre Père » par les quatre dernières demandes, dans lesquelles il s’agit de la question de ce qui fait de l’homme un être – vraiment – humain.
Quand et où ? Nous nous retrouverons encore une fois par téléphone. Vous recevrez les dates d’accès courant jeudi 20 mai. – De nouveaux participants seront les bienvenus. Veuillez vous inscrire sous hartmut.keitel@christuskirche.fr.

CERCLE DE JEUX - 21 mai - 18 h 30 - sous forme de quiz par téléphone
Vendredi prochain, nous nous retrouverons pour un nouveau tour de quiz. Merci à celles et à ceux qui prépareront des questions. Mais ce n’est pas obligatoire pour participer. Nous nous réjouissons déjà de votre participation !
Quand et où ? Si vous nous contactez le jeudi 20 mai avant midi sur newsletter@christuskirche.fr], nous vous enverrons les coordonnées d’accès courant vendredi.
 ICI & AILLEURS - Le pasteur Hans-Helmut Peters et son « Service pour la paix de demain ou encore après-demain » - Première Partie
ICI & AILLEURS - Le pasteur Hans-Helmut Peters et son « Service pour la paix de demain ou encore après-demain » - Première Partie
J’aime bien feuilleter la « Chronique de la paroisse », éditée en 1994 à l’occasion du 100ème anniversaire de la Christuskirche par le pasteur de l’époque, Wilhelm von der Recke. Il y a quelques passages tellement passionnants qu’ils auraient pu provenir de la plume de John le Carré, dans l’un de ses romans d’espionnage, en particulier le chapitre « La Paroisse à l’époque de l’Occupation allemande – août 1940 à août 1944 ». De quelle façon se présente « l’Église en tant que partie des forces d’occupation à l’étranger » ?(Chronique de la paroisse → Chr., p. 181) « Comment le pasteur s’est-il comporté dans cette situation ? Quels furent ses mobiles ? Qu’est-ce qui lui restait comme champ d’action ? » (Chr., p. 181) – Depuis juillet 1940, le francophile Hans-Helmut Peters qui, lors de son ‹ proposanat › en 1930/31, avait déjà fait la connaissance de Paris et qui, dans les années trente, avait été actif comme prédicant ambulant à Nice, officia comme pasteur.
Une lettre de l’Ambassade allemande datant de l’été 1940 montre que, « en premier lieu, Peters s’est rendu à Paris en tant que chargé par les institutions de l’État et que son activité comme pasteur de paroisse doit être considérée comme un camouflage de sa véritable tâche : pousser les protestants français à coopérer avec les Allemands. » (Chr., p. 184) La SS, elle aussi, était d’accord avec la nomination du pasteur Peters. Au cours des années suivantes, les activités pastorales de Peters seront appréciées d’un peu partout parce qu’il agit, pour ainsi dire, « entre les lignes » et ce, de façon très humaine. Dans la situation précaire de la période d’occupation allemande, il ne montra aucun penchant idéologique pour des doctrines et convictions nationales-socialistes. Pour lui, la rencontre d’homme à homme est au centre, « avec des hommes très différents : avec le résistant français, avec le membre de la SS, avec l’ouvrier et avec le général. » (Chr., p. 186) En septembre 1941, Peters fut nommé « pasteur de garnison à titre accessoire » pour les soldats allemands. De même, il se rendit, en plus de son travail comme pasteur rue Blanche, à la prison militaire de Fresnes afin d’assister des prisonniers civils protestants français, mais aussi d’autres incarcérés. On sait peu de choses sur cette activité parce que, « de par sa nature, elle se passait en semi-public, et que Peters n’a rien laissé de ses documents de travail. » (Chr., p. 187) La Chronique note que l’activité en tant qu’aumônier de prison « a dû être la tâche la plus difficile à effectuer, tâche pour laquelle le pasteur avait le plus besoin de force. Pour lui, elle était la plus importante. » (Chr., p. 194) La tâche de l’accompagnement spirituel des prisonniers civils protestants français lui fut confiée par le général Hans Speidel, anciennement conseiller de légation à l’Ambassade d’Allemagne. « Dans la prison de Fresnes furent incarcérés de nombreux résistants français qui avaient été arrêtés par la police allemande. Ce fut une maison d’arrêt réservée aux détenus provisoires, donc une station transitoire où l’on attendait le jugement. Une cour militaire décida du sort : exécution ou peine de prison ou déportation. » (Chr., p. 194) Comme son collègue catholique de l’époque, l’Abbé Stock, Peters accompagnait les condamnés à mort au Mont Valérien lors de l’exécution et assistait les familles. Dans la Chronique, une femme témoin de l’époque nous apprend ceci de l’activité de Peters : « Le pasteur Peters était connu partout. Il n’était pas résistant, il a fait, en tant que pasteur, tout ce qu’il avait à faire, consciencieusement. Il a rendu visite à des prisonniers français. Eh bien ! il a fait beaucoup plus que ce qu’il avait le droit de faire. Mais on le laissait tranquille parce que c’était lui. (…) Parfois, Peters a dit qu’il aurait toujours pu être arrêté parce qu’il ‹ était limite ›. D’un point de vue pastoral, il faisait ce qu’il y avait à faire, et naturellement, il a aidé beaucoup de personnes qu’il n’aurait pas eu besoin de connaître. » (Chr., p. 195) Dans ses mémoires, Peters rapporte que, « lors des visites dans les cellules, [il] constata que les prisonniers éprouvaient une grande envie d’avoir des nouvelles de leurs familles. Je savais très bien qu’un contact avec les familles ne devait pas être établi par mes soins. (…) Mais, de l’autre côté, il était clair pour moi que cela pourrait être un moyen de faire la paix et que les membres de la famille ressentiraient un soulagement psychique énorme s’ils savaient qu’ici, ‹ nous pouvons parler avec une personne qui a rendu visite à nos incarcérés. › C’est l’origine des heures de rendez-vous/consultations, le mercredi après-midi, auxquelles se présentaient entre 30 et 40 personnes, à certains moments. En secret, je me suis reproché encore et encore que, ‹ parmi eux, il y a un espion de la Gestapo qui est venu uniquement pour dire à la fin, Ce que vous faites est illégal et nous devons vous arrêter. › Pendant tout mon temps à Paris, je me suis toujours attendu à être arrêté ; parce que, en prison aussi, il s’est passé des choses à la limite, et vraisemblablement aussi en dehors, de la légalité. (…) Mais je me suis toujours consolé en disant : si Dieu veut que ce service, que je considérais comme service pour une paix de demain ou après-demain, – si Dieu veut que ce service prenne fin, alors ainsi soit-il ; et s’il me tient dans le creux de Sa main, je veux continuer à servir les hommes, aussi bien que possible. » (Chr., p. 196)
Pour son activité à Fresnes, Peters a obtenu de la reconnaissance, également de la part du Conseil national de la Fédération Protestante. Peters ne fut sans doute pas un résistant ; il ne manifeste pas une attitude ouvertement critique à l’égard du Troisième Reich. Il a compris son travail comme « un service pour la paix de demain ou encore après-demain ». Pour lui, fut important « l’aide humaine en tant que pont entre des nations en guerre vers un accord de paix ultérieur, comme une sorte de capital afin d’arriver de nouveau à une relation de confiance. Montrer aux Français que les Allemands ne font pas tous du mal à leurs semblables, aux autres ; que le fait d’être humain existe par-delà toutes les différences qui nous séparent. » En cela, Peters resta fidèle à son attitude des années trente où il savait parler aussi bien au membre de la SS qu’au représentant de l’Eglise confessante (Bekennende Kirche). » (Chr., p. 201)
Concernant le chapitre « La Paroisse à l’époque de l’Occupation allemande », la remarque suivante se trouve dans la Chronique : « Tout ce chapitre doit être lu sous réserve ; il reflète l’état des connaissances au printemps 1994. Les sources sur lesquelles le texte est basé sont incomplètes. » (Chr., p. 181) Depuis, une nouvelle source est apparue, source dans laquelle un témoin d’époque parle de son contact avec le pasteur Peters, à la prison de Fresnes. À lire dans la prochaine Newsletter : « Comment le pasteur Peters sauve la vie d’un prisonnier célèbre ».
Pasteur Hartmut Keitel
Merci de visiter régulièrement notre site www.christuskirche.fr pour découvrir les dernières nouvelles.
25 rue Blanche, 75009 Paris. Métro: Trinité, Blanche, Liège.
 Sie möchten die Gemeinde mit einer Spende unterstützen, die steuerlich absetzbar ist? Zwei Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: entweder die Online-Spende oder die Überweisung beim Crédit du Nord. Im Gemeindebüro können Sie Informationen zur Absetzbarkeit der Gemeindebeiträge und zur Regelung für Rentner erhalten.
Sie möchten die Gemeinde mit einer Spende unterstützen, die steuerlich absetzbar ist? Zwei Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung: entweder die Online-Spende oder die Überweisung beim Crédit du Nord. Im Gemeindebüro können Sie Informationen zur Absetzbarkeit der Gemeindebeiträge und zur Regelung für Rentner erhalten.Vous souhaitez soutenir la paroisse avec un don, qui ouvre droit à une réduction fiscale?
Deux solutions s'offrent à vous: un don en ligne ou par virement auprès du Crédit du Nord. Au secrétariat de la paroisse,
Deux solutions s'offrent à vous: un don en ligne ou par virement auprès du Crédit du Nord. Au secrétariat de la paroisse,
vous pouvez obtenir des informations sur les réductions fiscales des dons et la règlementation pour les retraités.
Crédit du Nord - IBAN: FR76 3007 6020 2418 4071 0020 072 - BIC: NORDFRPP
Ich möchte den Newsletter abonnieren. > < Je souhaite m'abonner à la newsletter.